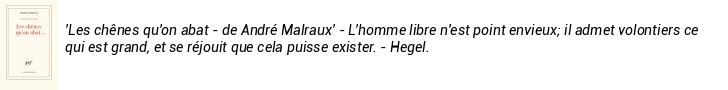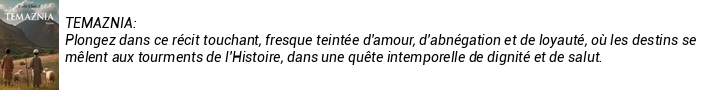Monnaie libre, monnaie pleine, cryptomonnaie, monnaie hélicoptère, drone monétaire, monnaie moderne, monnaie positive, monnaie écologique, etc. de la monnaie comme s’il en pleuvait ces derniers temps dans les travaux des économistes. Ça n’a pas été toujours le cas, car, entre les économistes et la monnaie, c’est plutôt : « je t’aime, moi non plus ».
Entre ceux qui n’y voient que désir d’accumulation capitaliste et ceux qui, à l’inverse, dans une tradition ancienne héritée des classiques et néo-classiques, continuent d’y voir un simple voile autour des échanges, sans autre effet sur l’économie réelle qu’un effet sur les prix, bien peu (trop peu) d’économistes se sont intéressés à la monnaie au cours des siècles passés. L’effervescence récente autour de ce sujet ne provient d’ailleurs pas tant d’un intérêt spontané des économistes pour le sujet de la monnaie, mais du fait que les crises, celle, financière, de 2007-2008, puis la crise sanitaire actuelle, les obligent à s’en emparer.

Si les économistes de l’école classique, Adam Smith, David Ricardo ou Jean‑Baptiste Say ont réduit la monnaie à un pur instrument de facilitation de l’échange, c’est parce que leur analyse de l’échange s’est d’abord focalisée sur la valeur, le prix n’étant pour eux que l’expression de cette valeur. La monnaie apparaît alors comme le meilleur intermédiaire des échanges, mais n’est que cela.
Dans cette optique, les classiques ont assez largement nourri la « fable du troc » décrite par l’économiste Jean‑Michel Servet : la monnaie aurait été inventée, un beau jour, pour dépasser les contraintes du troc et faciliter l’échange. De quoi faire sourire des générations d’historiens et d’anthropologues, dont les recherches montrent que la plupart des sociétés humaines, y compris les sociétés « primitives », ont eu recours à des instruments monétaires perpétuant des pratiques à caractère non pas fondamentalement marchand au départ mais plus largement social et politique.
La monnaie, ça compte !
Les néo-classiques, dans le sillage de Léon Walras en 1874 puis de Kenneth Arrow et Gérard Debreu en 1954, ont quant à eux entrepris d’établir un modèle d’équilibre « général », en excluant la monnaie de leur raisonnement. Ils ont ensuite essayé de l’y introduire après coup, mais uniquement pour vérifier que leurs résultats ne s’en trouvaient pas perturbés ! Et ils s’y sont cassé les dents, y compris Don Patinkin, le plus engagé d’entre eux dans cette entreprise « d’intégration » de la monnaie à l’économie « réelle ». Pour eux, la monnaie demeure un voile.

Il faut attendre John Maynard Keynes pour réaliser l’importance de la monnaie dans l’économie, c’est-à-dire sa non-neutralité. Keynes rompt avec le cadre d’analyse des néo-classiques et leur vision dichotomique des sphères réelle et monétaire qui, selon lui, n’a pas de sens. Ce n’est pas dans une économie d’échanges réels (c’est-à-dire sans monnaie) qu’il faut raisonner, mais dans celui d’une « économie monétaire de production » : la monnaie, ça compte !
D’ailleurs, quand Keynes revisite les fonctions de la monnaie, la plus importante selon lui est celle de l’unité de compte, comme il le souligne dans les premières pages de son plus long ouvrage, longtemps resté dans l’oubli, A Treatise on Money (1930). Dans la Théorie générale (1936), ouvrage qui aura plus d’influence, il enfonce le clou avec la théorie de la préférence pour la liquidité. La monnaie peut être demandée pour elle-même et les individus peuvent être victimes d’illusion nominale. Par exemple, une augmentation de 5 % sur la fiche de paie quand le taux d’inflation est à 5 % est préférée à l’absence d’augmentation quand le taux d’inflation est à 0, alors qu’en termes réels celles-ci reviennent au même.
Le temps et l’incertitude, absents du cadre originel des néo-classiques, sont au cœur de la théorie élaborée par Keynes. La monnaie devient alors primordiale car elle est un « pont entre le présent et le futur ».
La création monétaire absente des modèles
L’analyse monétaire de Keynes n’est cependant pas exempte d’ambiguïté. La Théorie générale n’offre pas d’explication claire de l’origine de la monnaie et de son offre. Keynes se contente d’écrire que le stock de monnaie est une des « données » de l’économie, ou d’indiquer, de manière elliptique, que la quantité de monnaie est « déterminée par l’action de la banque centrale ». La monnaie semble exogène.
À l’inverse, le Treatise on Money, et surtout les articles sur le « motif de finance » publiés après la Théorie générale, ouvrent la voie à une vision endogène de la monnaie : la quantité de monnaie n’est pas une donnée exogène, constante ou fixée par la banque centrale, mais une variable déterminée par la demande de financement de l’économie. Comprendre la monnaie n’est pas une démarche aisée, comme on le voit, même pour le maître de Cambridge !
Parmi ses héritiers, les post-keynésiens reprennent et enrichissent cette vision de la monnaie endogène : la monnaie est endogène car elle est créée en réponse aux besoins de l’économie. Sans monnaie, pas de production et d’échanges, et donc pas d’économie. Cette hypothèse de monnaie endogène est essentielle pour comprendre le mécanisme de la création monétaire, sans doute l’un des mécanismes les plus mal compris et à l’origine de nombreuses controverses.
Jean François Ponsot : « Qu’est-ce que l’économie post-keynésienne ? »
Dans les économies modernes, la création monétaire est, en effet, le résultat d’une réponse des banques à la demande de crédits des agents économiques. Les banques ont le « pouvoir de création monétaire », que la banque centrale leur délègue en vertu de la délégation qu’elle-même se voit confiée par les pouvoirs publics : les crédits que les banques octroient à leurs clients font les dépôts de ces mêmes clients et donc la monnaie qui circule dans l’économie.
Une part de la monnaie en circulation correspond aux billets qui ne sont pas une monnaie de banques commerciales, mais une monnaie de banque centrale. Car la banque centrale a aussi ce pouvoir de création monétaire : sa monnaie est celle créée, selon le même mécanisme, en réponse aux besoins de liquidité des banques, donc inscrite sur le compte des banques au passif de la banque centrale. Cette monnaie scripturale de banque centrale ne circule qu’entre les banques, mais sa disponibilité plus ou moins grande influence leur capacité de réponse aux besoins de financement de l’économie.
Pour autant, la création monétaire et le processus dynamique de circulation de la monnaie dans l’économie sont totalement absents des modèles macroéconomiques contemporains, comme ceux utilisés par les banques centrales et les institutions financières internationales…
Même rejet dans la microéconomie contemporaine appliquée à la banque. La théorie bancaire fait paradoxalement abstraction de la création monétaire : que l’on pense aux modèles fondateurs (ceux de Douglas Diamond (1984), ou Diamond avec Philip Dybvig (1983)), ou à leurs prolongements, ceux-ci ont beau traiter d’une manière stimulante des raisons d’être de l’activité bancaire, il n’est nulle part question de monnaie, les banques n’y sont que de purs intermédiaires financiers : elles s’interposent entre des déposants auprès desquels elles collectent des ressources, et des emprunteurs à qui elles les prêtent. Jamais n’est prise en compte cette capacité qu’ont les banques de créer elles-mêmes ce qu’elles doivent à leurs clients.
Quand la monnaie devient une phobie…
Et quand la monnaie n’est pas ignorée par la théorie économique, pire, elle est pour ainsi dire honnie. Il en va ainsi de la théorie monétariste héritée de Milton Friedman. La monnaie n’a pas d’autre effet sur l’économie que son influence sur le niveau général des prix : qu’elle vienne à circuler trop abondamment et c’est l’inflation assurée.

Mal absolu, dévorant le pouvoir d’achat des ménages, l’inflation est pour Friedman « toujours et partout un phénomène monétaire ». Dans sa perspective, la politique monétaire de relance à la mode keynésienne est à bannir car jamais elle n’atteindra son but : elle élève le niveau de l’inflation et finit par faire remonter le chômage à son niveau naturel ou structurel. La seule mission à confier aux banques centrales, dans le cadre de la politique monétaire, devient donc la stabilité des prix à partir d’un contrôle attentif de l’évolution de la masse monétaire.
Les macroéconomistes de la nouvelle économie classique de la fin du XXe (Robert Lucas, Robert Barro, Finn Kydland et Edouard Prescott…) vont encore plus loin dans la phobie de la monnaie : la politique monétaire devient « super nocive ». Les banques centrales, garantes de la stabilité de la monnaie, doivent donc impérativement être indépendantes du pouvoir politique ! Le pouvoir discrétionnaire du décideur politique, ou du banquier central, doit laisser place à des règles automatiques. Il n’est plus question de mettre la banque centrale au service du politique pour l’aider à relancer l’économie. À cette aune, autant dire que les perspectives actuelles de monétisation des États par les banques centrales sont un cauchemar absolu pour ce courant de pensée encore très présent aujourd’hui.

La monnaie fait également assez peu d’émules parmi les hétérodoxes. Car les héritiers de la tradition marxiste n’y voient que l’objet du désir d’accumulation capitaliste. C’est cependant parmi les économistes hétérodoxes français que l’on trouve des théoriciens de la monnaie. Michel Aglietta et André Orléan (1982) sont les premiers à mettre en lumière l’ambivalence de la monnaie, objet de désir mais aussi lien social par excellence. La monnaie devient dans leur approche constitutive de l’échange. Peu importe le support de la monnaie, qu’il s’agisse d’une marchandise, d’un métal précieux, d’un morceau de papier, d’une écriture dans un livre de compte ou écriture numérique, la monnaie est une institution reposant sur la confiance et sur une communauté.
La libéralisation financière, amorcée dans les années 1970-1980, n’a pas aidé à réconcilier les économistes avec la monnaie. En favorisant une expansion sans précédent de la sphère bancaire et financière, dont la crise financière de 2007-2008 a légèrement infléchi la tendance sans la renverser totalement, la libéralisation financière a financiarisé l’économie. Et cette financiarisation a, tout à la fois : brouillé la frontière entre la monnaie et les titres rendant la monnaie encore plus difficile à appréhender ; étendu le domaine de circulation de la monnaie ; et décuplé le pouvoir de création monétaire des banques.
Après 2008, l’ère des innovations monétaires
C’est l’innovation financière, qui a brouillé la frontière entre la monnaie et les titres, en accouchant, au tournant des années 1970-1980, d’instruments combinant la rentabilité des titres financiers avec la liquidité de la monnaie : c’est ainsi que sont apparues les parts de fonds monétaires, amenant à étendre la définition des agrégats monétaires.
Quant au domaine de circulation de la monnaie, il s’est étendu à une sphère financière croissant à une vitesse exponentielle et se déconnectant de l’économie réelle. C’est ainsi que s’est distendu le lien supposé entre la quantité de monnaie en circulation dans l’économie et le niveau des prix des biens et des services.
Comme la monnaie circule en plus grande quantité et à plus grande vitesse dans la sphère financière, ses variations causent celles des prix des actifs financiers et immobiliers, jusqu’à parfois former des bulles source d’instabilité financière, bien moins celle des prix des biens et services sur la base desquels l’inflation est mesurée. Et, enfin, le pouvoir de création monétaire des banques s’est étendu à la mesure de leurs activités déployées sur les marchés financiers : ce ne sont plus seulement les crédits qui font les dépôts, mais aussi les achats de titres et de produits financiers divers et variés.
Ces évolutions ont pu alimenter le sentiment d’un pouvoir excessif et dévoyé des banques. Des propositions s’en font l’écho, qui remettent au goût du jour le 100 % monnaie d’Irving Fisher dans les années 1930 : la monnaie devrait être à 100 % de la monnaie centrale. L’initiative « monnaie pleine » en Suisse avait dans cette perspective soumis à la votation populaire de juin 2018 la question suivante : « Qui doit créer notre argent : les banques privées ou la banque nationale ? ».

Cette initiative (rejetée à plus de 75 %) est assez emblématique de la période post-2008. La crise financière et la défiance qu’elle a suscitée envers les banques, mais plus largement envers l’ensemble des institutions du système financier, ont en effet constitué un terrain fertile pour les innovations monétaires. Le bitcoin et les cryptomonnaies, d’un côté, et les monnaies locales complémentaires, de l’autre, n’ont pas grand chose en commun dans leurs systèmes de valeurs respectifs.
D’un côté, un système de monnaie virtuelle créé par une communauté de geeks, emmenée par Satoshi Nakamoto (groupe ou personne peu importe), contestant l’emprise des États et des banques centrales. De l’autre, des instruments monétaires alternatifs développés par des associations d’économie sociale et solidaire visant à reconstituer un lien social et à revitaliser des territoires en redéfinissant un espace de circulation et d’usage d’une monnaie locale. Dans les deux cas, cependant, s’exprime une volonté forte de se réapproprier la monnaie et de mieux l’asseoir sur les valeurs d’une communauté.
Faire décoller des hélicoptères monétaires ?
La crise sanitaire que nous vivons actuellement fait également surgir d’épineuses questions monétaires qui s’entremêlent avec des questions budgétaires. Les dépenses publiques que les États doivent engager pour compenser des pertes et tenter de limiter la dépression qui s’annonce posent en effet la question du mode de financement à privilégier. Comment les banques centrales doivent-elles agir face à cette crise ? Comment doivent-elles financer les États ? Doivent-elles simplement faciliter leur financement par des achats de titres sur les marchés de la dette, comme elles le font avec leur programme d’assouplissement quantitatif (quantitative easing) ?
Ces achats massifs sont assurément un soutien à la dépense publique, mais comme ils ajoutent de la dette à la dette, des voix s’élèvent pour interroger la question de la soutenabilité de cette dette : cela ne fait-il pas courir, tout particulièrement pour les États de la zone euro, le risque d’une insoutenabilité à terme de la dette, qui pourrait conduire à une réédition de la crise des dettes souveraines ? Faudra-t-il envisager des annulations pures et simples des dettes ?
Pour les tenants de la théorie monétaire moderne (comme Stephanie Kelton, aux États-Unis, dont l’influence a été grande auprès de Bernie Sanders dans l’actuelle campagne des démocrates à la présidentielle), un financement des dépenses publiques par un transfert direct et sans contrepartie de la banque centrale serait la meilleure option pour permettre aux États de piloter une relance de grande ampleur et de mener une politique d’employeur en dernier ressort.
La monétisation, entendue au sens d’un transfert direct de monnaie centrale aux États sans contrepartie fait également partie des options de financement pour orienter la monnaie de la banque centrale vers la transition écologique (monnaie écologique), à côté d’autres propositions, de dettes perpétuelles, d’annulations de dettes publiques conditionnelles à des investissements verts, etc. qui permettraient d’accélérer la transition écologique.
??#Covid19 Des annulations de dette publique par la BCE : lançons le débat
— Terra Nova (@_Terra_Nova) April 17, 2020
?L'analyse de @LaurenceScialom et Baptiste Bridonneau pour @_Terra_Nova
?https://t.co/ANuYYSqb95 pic.twitter.com/piOeH5OUKl
La monnaie centrale pourrait aussi être directement transférée aux ménages et aux entreprises, pour venir directement augmenter la dépense globale sans se heurter aux problèmes de transmission que rencontre la politique monétaire lorsqu’elle passe par les canaux bancaires et financiers. Faire décoller des hélicoptères et des drones monétaires, ou rendre la monnaie « positive », fait partie des débats académiques suscités par la crise sanitaire, même si ces propositions pénètrent difficilement l’univers très feutré des banques centrales.
Tels sont les débats du moment, ils sont vifs, prolifiques et essentiels au débat démocratique. Ce sont des débats sur la nature et le rôle d’une institution majeure, trop longtemps négligée par les économistes : la monnaie. Son rôle à court terme, pour éviter l’effondrement de l’économie. Mais aussi à long terme, pour répondre aux défis sociétaux, démographiques et environnementaux qui nous attendent dans les prochaines décennies. Il est grand temps que les économistes se réconcilient avec la monnaie !
Jézabel Couppey-Soubeyran, Conseillère éditoriale au CEPII, maître de conférences en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jean-François Ponsot, Professeur des universités, Université Grenoble Alpes (UGA)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.